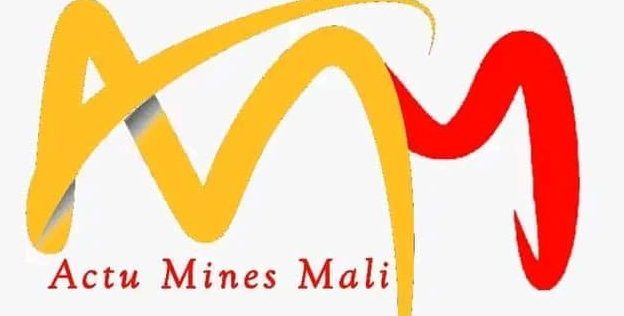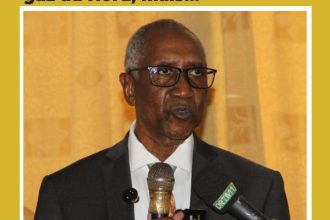Lors d’une intervention télévisée en juin 2024, le président du Front pour l’Émergence et le Renouveau au Mali (FER-Mali), M. Sory Traoré, a révélé que plus de 60 tonnes d’or issues exclusivement de l’orpaillage artisanal quittent chaque année le Mali à destination de Dubaï. Cette affirmation repose, selon lui, sur une étude menée par les Émirats arabes unis.
M. Traoré estime que le secteur de l’orpaillage, s’il est mieux structuré et encadré par l’État, pourrait constituer un véritable levier d’indépendance économique pour le pays. Car , dira-t’il, le pays dispose de nombreux sites d’orpaillage dont le contrôle échappe au pouvoir central. Cela constitue un véritable manque à gagner par l’Etat, a-t-il regretté.
« Le Mali compte aujourd’hui plus de 500 sites d’orpaillage produisant environ 60 tonnes d’or par an, et tout cet or prend la direction de Dubaï », a-t-il souligné. Et d’ajouter : « Tout l’or qui quitte le Mali pour se retrouver à Dubaï est issu de l’orpaillage traditionnel. Il est temps que les autorités accordent une attention particulière à ce secteur stratégique», interpelle Sory Traoré.
De plus en plus, des voix s’élèvent pour appeler à l’encadrement du secteur d’orpaillage. Le géologue Djibril Diallo dénonce aussi la mauvaise organisation de l’orpaillage au Mali. Selon lui, l’État ne prend pas ses responsabilités pour structurer et réguler ce secteur stratégique.
Pratiqué depuis l’époque de l’empereur Kankou Moussa, l’orpaillage a connu une évolution notable. D’abord artisanal, il s’est progressivement modernisé grâce à l’usage de machines sur les sites d’extraction. Mais cette modernisation, selon M. Diallo, ne s’est pas accompagnée d’un encadrement adapté.

Un secteur vital mais désorganisé
« L’orpaillage est aujourd’hui l’activité qui emploie le plus de Maliens », a déclaré l’expert. Plus d’un million de personnes travaillent directement dans ce domaine, tandis que près de deux millions d’autres en vivent à travers des activités connexes — commerces, vente de carburant, restauration et autres services.
Pourtant, cette manne potentielle échappe largement à l’État. « Le secteur est très mal organisé et encadré, ce qui entraîne d’énormes pertes économiques », regrette Djibril Diallo.
Un appel à s’inspirer de modèles régionaux
Face à ce constat, Djibril Diallo exhorte l’État malien à s’inspirer des expériences réussies du Ghana et de la Côte d’Ivoire, où le secteur aurifère est mieux structuré et encadré, générant ainsi des retombées économiques importantes pour l’État.
La rédaction